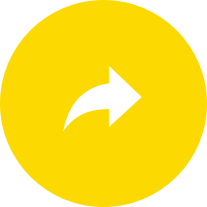Si le chiffre de 68,6 milliards d’euros de travaux déclarés sur l’année est conséquent, il masque aussi des réalités contrastées. Certains segments du marché, comme les bureaux, explosent quand d’autres, à l’image du logement, montrent les premiers signes d’essoufflement. Cette photographie annuelle permet de comprendre les mutations profondes qui traversent actuellement le secteur de la conception architecturale.
Un volume d’activité sans précédent
La construction de bureaux porte les bons résultats du secteur. Avec une hausse de 49,5 %, ce secteur a généré près de 3 milliards d’euros d’activité supplémentaire. Cette dynamique positive s’étend aux secteurs de la culture-loisirs (+20,6 %) et du stockage (+22,1 %).
À l’inverse, le logement marque le pas et affiche une légère contraction de 1,1 %, signe avant-coureur d’une tendance baissière que les prochains exercices devraient confirmer.
Les missions d’architecte en pleine mutation
La répartition entre construction neuve et rénovation révèle des tendances de fond qui structurent le marché architectural. Si les travaux neufs dominent toujours largement avec 68,5 % de l’activité, ils perdent 1,2 point au profit de l’entretien-réhabilitation qui représente désormais 31,5 % des interventions des architectes.
Cette progression de la rénovation s’inscrit dans une dynamique de long terme. Les données MAF confirment que l’entretien-amélioration gagne régulièrement du terrain dans l’activité des concepteurs, répondant aux enjeux de durabilité et aux contraintes foncières actuelles.
Point préoccupant pour la profession : l’érosion continue du taux de pénétration des architectes dans le marché global du bâtiment. Malgré des volumes en hausse, leur part de marché recule face à d’autres acteurs de la construction. Côté commanditaires, la maîtrise d’ouvrage privée renforce sa prédominance avec 73,3 % des commandes, contre 26,7 % pour le public.
L’Île-de-France | Locomotive d’un train à plusieurs vitesses
La géographie de l’activité architecturale française dessine une carte fortement contrastée. L’Île-de-France s’impose plus que jamais comme la locomotive nationale avec une progression de 20,7 %. À elle seule, la région capitale génère 25 milliards d’euros d’activité, soit plus du tiers des travaux déclarés par les architectes français.
Derrière la capitale, l’Auvergne-Rhône-Alpes se distingue avec 9,2 milliards d’euros de travaux (+ 1,3 %), qui entérinent son statut de deuxième région la plus dynamique du pays. Quant aux régions Nouvelle-Aquitaine, Occitanie et PACA, elles affichent des volumes d’activité similaires, mais avec des trajectoires contrastées. En Nouvelle-Aquitaine, le montant des travaux atteint 5,7 milliards d’euros, mais la croissance reste limitée. L’Occitanie progresse de + 3,7 %, tandis que PACA affiche une hausse plus marquée de + 6,3 %.
Les disparités régionales sont marquées, avec des écarts significatifs entre territoires. Mayotte connaît une envolée spectaculaire de + 32,2 %, illustrant l’impact de projets structurants sur l’économie locale. À l’inverse, la Guyane accuse un fort ralentissement (- 10,8 %), révélant un marché en contraction après plusieurs années plus favorables.
Portrait-robot d’une profession en transformation
L’architecture française évolue, portée par des mutations profondes dans la démographie et les modes d’exercice. Le vieillissement de la profession constitue un phénomène majeur : en 2023, l’âge moyen des architectes s’élève à 53,6 ans, une tendance alignée sur l’évolution démographique nationale. Cette réalité soulève d’importantes questions quant au renouvellement générationnel et aux défis structurels pour la pérennité du métier.
En parallèle, la féminisation continue de progresser. Avec 35,6 % de femmes architectes, la profession se rapproche petit à petit de la parité. Si cette tendance se maintient, les projections estiment que l’égalité hommes-femmes pourrait être atteinte d’ici 2030.
Enfin, le mode d’exercice des architectes connaît une transformation majeure. Le statut libéral est en déclin, représentant désormais moins de 21 % des professionnels, tandis que le statut en société séduit de plus en plus, avec à la clé davantage de sécurité et de stabilité dans un environnement économique incertain.
Autre tendance forte : la multiplication des collaborations. Les montants de travaux réalisés avec des cotraitants ou sous-traitants non-architectes atteignent désormais 66,4 % du total, contre 33,6 % pour les projets menés sans partenaires. Une illustration concrète de la complexification croissante des opérations architecturales.
Radiographie des risques de la construction
L’analyse des sinistres révèle les points de vulnérabilité persistants dans la construction. En 2023, 65 % des déclarations relèvent de la garantie décennale.
Les infiltrations par inétanchéité demeurent le talon d’Achille du bâti (29 % des désordres déclarés). Le logement concentre 70 % des sinistres, une proportion nettement supérieure à sa part dans l’activité globale. Mais la répartition n’est pas homogène : si les logements collectifs génèrent le plus grand nombre de sinistres (47 %), les maisons individuelles présentent un coût moyen de réparation bien plus élevé (20,6 k€ contre 11,4 k€).
L’édition des Chiffres MAF est à retrouver sur votre espace adhérent.